 Stéphanie Gaou, fille de la méditerranée, est installée à Tanger depuis presque 10 ans. Sa rencontre avec la Cité du Détroit relève de la passion et d’une vision qui s’inscrit dans le devenir d’une ville qui va très vite en avant et tant mieux. Il y a trois ans elle a créé la librairie les insolites, un concept nouveau à Tanger. Et l’an dernier elle a publié « Capiteuses », son premier livre. C’est un succès d’estime. Directe, incisive, décidée, riche d’un beau langage, sensible aussi elle nous livre ses impressions, son feeling, ce qu’elle vit ici et ailleurs. Des lectrices et des lecteurs parlent également de « Capiteuses »…
Stéphanie Gaou, fille de la méditerranée, est installée à Tanger depuis presque 10 ans. Sa rencontre avec la Cité du Détroit relève de la passion et d’une vision qui s’inscrit dans le devenir d’une ville qui va très vite en avant et tant mieux. Il y a trois ans elle a créé la librairie les insolites, un concept nouveau à Tanger. Et l’an dernier elle a publié « Capiteuses », son premier livre. C’est un succès d’estime. Directe, incisive, décidée, riche d’un beau langage, sensible aussi elle nous livre ses impressions, son feeling, ce qu’elle vit ici et ailleurs. Des lectrices et des lecteurs parlent également de « Capiteuses »…
Stéphanie Gaou, vous êtes à Tanger depuis une dizaine d’années, qu’est-ce qui vous a motivée pour vous installer ici ? Je crois que rien ne motive à aller quelque part en un lieu qui n’est pas celui de notre naissance, si ce n’est justement, cet appel du lieu, ce désir d’aller vers soi en découvrant l’autre. Tanger était ma sirène africaine, une sorte de retour aux sources illusoires de ce que j’avais envie d’imaginer sur moi. Je m’ennuyais beaucoup en France. J’avais toujours envie d’arriver quelque part. Je passe mon temps à faire mes bagages. Il s’est avéré que ce lieu avait raison de m’appeler, que je m’y fonds souvent comme en une rivière. Que j’aime aussi cette sorte d’ancrage ponctuel dans l’Afrique qui est mienne au cœur depuis toujours, et que je trouve ici, même si c’est une Afrique blanche, comme je le suis d’ailleurs.
Au départ, vous vouliez faire quoi à Tanger ? Sensiblement ce que je fais dans le lieu que j’ai créé, les Insolites. Sauf que j’avais davantage d’ambition, je voulais profiter d’un espace plus grand, j’avais même acheté avec mon ex-mari une maison ancienne avec jardin à Marshan pour réaliser ce projet. Un lieu très ouvert, qui aurait fonctionné au feeling, avec des gens de passage du monde entier qui auraient laissé leur empreinte, des endroits où se poser pour manger, s’arrêter, divaguer et rêver devant des œuvres choisies, de la photo, des bouquins partout, des tableaux. Cela n’a pas pu se faire pour tout un tas de raisons purement matérielles. Mais l’envie est restée. Et les Insolites sont nés longtemps plus tard. Plus modestement, certes, mais avec le même punch, la même niaque de mettre en avant le Maroc créatif et artiste de maintenant, et pas d’encenser de façon un peu stérile le passé, comme il est d’usage de le faire à Tanger.

Vous écrivez depuis quand et quel est votre rapport à l’écriture ? Depuis que je sais écrire, c’est-à-dire un petit bout de temps maintenant. J’ai un rapport sensuel à l’écriture, je me mets à écrire quand j’ai un besoin de tendresse à mon égard, mais aussi de réclusion, quand je suis en verve verbale dans mon esprit. Il y a parfois aussi une urgence à noter, vite, n’importe où, n’importe comment, n’importe quand, une phrase, un ressenti sur une scène de film, ce que je vois à une terrasse de café, les gens assis à côté de moi à la plage, dans le train, le son des voix qui disent des mots que je ne comprends pas mais dont j’apprécie la mélodie, la photographie que je ne saurai pas prendre mais qui est là, vivace, un bruit qui vient du dehors, la phrase d’un homme qui partage un moment de ma vie, ce que peuvent dire des inconnus, des amis, n’importe quoi qui fait déclencheur. C’est comme l’urgence de respirer, pour moi, d’écrire, comme l’urgence de vivre.
Capiteuses est votre premier bouquin ? En mon nom, oui. Mais j’ai aussi beaucoup écrit en collaboration avec d’autres artistes. Leur attente est un vrai déclic pour moi, travailler avec d’autres artistes venus d’autres univers, me galvanise complètement. J’ai écrit pour des courts-métrages, des collectifs de poésie, des livres de photographies. J’aimerais beaucoup écrire un scénario, une pièce de théâtre.
Comment passe-t-on du journal, » d’écrivaine du dimanche » au bouquin, au vrai que l’on édite et diffuse ? Je n’aime pas le terme « écrivaine du dimanche », il n’y a pas d’écrivain de jour de semaine en particulier. Je trouve très déplacée cette phrase de Léo Scheer, éditeur, qui dit « Un écrivain est quelqu’un qui a un éditeur. » Un écrivain, c’est un statut qui ne m’a jamais particulièrement excitée. Je ne me considère pas davantage écrivain maintenant qu’avant. Sauf peut-être que maintenant, j’appréhende mes mots avec la responsabilité qu’ils peuvent avoir sur celles et ceux qui les lisent, et c’est tout. Je dois faire plus attention qu’avant, et c’est une contrainte qui me dérange mais m’excite aussi.
Qu’est ce que ce livre représente pour vous ? Il est à la fois mon pire ennemi, car j’y ai mis beaucoup de ma vie émotive dedans, et mon plus merveilleux fantasme. Je voulais écrire en me démultipliant, je voulais incarner toutes ces femmes dont je parle, ces amazones modernes, ces garces pas très sûres de leur faits et gestes, ces romanesques. Je lutte contre l’étiquetage romantique versus pornographique. Ce n’est pas un livre qui réclame de l’amour, mais une certaine grandeur de geste de la part des femmes. Je trouve qu’elles en manquent parfois. Elles sont souvent tellement craintives de leurs infinis. Pas moi. Ni mes héroïnes.
Comment est venue l’idée de Capiteuses et pourquoi ce sujet, cette thématique de la confidence, de l’intime, de l’amour, du sexe aussi ? Parce que je crois faire partie de ces personnes qui ne vivent bien qu’en puisant en elles ce qui les fait buter ou avancer. Et que ce médium – l’écriture introspective ou émotive – est le seul qui me semble juste. Je parle pour moi, bien sûr. Il y a des auteurs qui n’existent que dans la fiction et qui le font très bien. Moi, je n’y arrive pas. Pas encore. Je peux parler des autres aussi, mais il faut qu’ils aient une connexion avec mon univers, mon vécu ou tout simplement mon ressenti.
Y-a t-il eu un élément déclencheur pour Capiteuses ? Oui. Une conversation avec un homme. Ces textes étaient épars dans plusieurs carnets de plusieurs années. En une nuit, je les ai réunis, compilés et envoyés pratiquement comme tels à quelques maisons d’édition. C’est Alain Gorius d’Al Manar qui a réagi le premier quelques heures plus tard. J’ai aimé ce qu’il m’en a dit : « C’est couillu. Je prends ».
Vous avez voulu raconter quoi dans ce livre ? Je n’ai rien voulu raconter. J’ai raconté. Ça venait tout seul. Les personnages, les scènes, je les ai souvent vus, il suffisait de faire la part de l’écrit, de dépasser le vécu…
Quelle est la part du vécu et de la fiction ? Le premier texte qui s’adresse à ma mère a existé mot pour mot dans nos dialogues. C’est celui qui fait le plus réagir les lecteurs. Il prend le lecteur à parti, et pourtant, je n’ai pas de compte à régler en écriture, je voulais juste dire ceci sur ce que je considérais comme très féminin avant d’être maternel: ce que j’avais vu de ma mère en femme, moi encore jeune fille, m’avait intriguée. A un moment de ma vie, j’ai eu l’âge qu’elle avait quand j’avais seize ans, j’ai compris bien des choses sur la féminité, je voulais qu’elle le sache. Le reste lui est dédié, et pourtant, elle est si peu présente dans les textes suivants. Je peux concevoir qu’il y ait une sorte d’impudeur à jeter ces mots ainsi, mais ils avaient leur indispensabilité, j’en suis toujours persuadée. Les autres textes sont souvent une extrapolation d’un vécu personnel ou vu. Il y a quelques scènes très intimes égrenées çà et là, mais de loin pas toutes. Pas du tout, même. Rien ne me fait autant sourire que les naïfs qui pensent bien me connaître parce qu’ils ont lu Capiteuses.
Cette zone de « non-droit » qu’est Tanger, cette ville de tous les dangers comme on dit, vous a t-elle particulièrement inspirée pour Capiteuses ? D’une certaine manière, oui, mais finalement, je ne cite quasiment jamais son nom. Et d’autres villes sont tout aussi inspirantes, voire plus, dans mon imaginaire. Lisbonne est particulièrement évocatrice pour moi. Rabat aussi, je n’ai jamais su pourquoi, j’ai beaucoup écrit à Rabat. Sa force tranquille apparente qui me donne envie d’aller y chercher la faille, ce qui fait résonance dans cette pseudo torpeur qui n’en est pas une. Et puis, je parle plus d’espaces que de villes nominatives. Ce qui m’intéresse, ce sont les liens qu’il y a entre les lieux, pas les noms qu’ils portent.

Cela donne l’impression d’une quête frénétique d’amour en testant sa réalité, sa force à l’aune du sexe, du fantasme, de l’érotisme comme s’il n’y avait que cela pour valider la vérité des sentiments ? Vous partagez ce ressenti ? Moi, non, mais mes narratrices, si. Et c’est ainsi, souvent, que j’ai ressenti le rapport à l’homme chez beaucoup de femmes. Ce recueil n’est pas un état des lieux de ma vie érotique, quoiqu’en disent certaines mauvaises langues qui se sont contentées de ne retenir que ce qui les a émoustillées et qui l’ont projeté sur moi. La vérité des sentiments n’a rien à voir avec l’authenticité du désir. J’ai toujours lutté contre cette aberration qu’ont les gens de confondre désir et amour. Il peut y avoir désir intellectuel de l’autre sans l’aimer ni le vouloir sexuellement, attente charnelle sans sentiment, sentiment et passion amoureuse… Il y a autant de formules chimiques qu’il y a d’êtres, essayons juste de l’admettre une bonne fois pour toutes. Et laissons parler nos émotions qui sont peut-être ce qui nous reste de si individuel. Parler en étiquettes d’émotions, ça ne se justifie que par l’intervention de la morale, de l’encodage des autres pour se rendre intelligible pour eux. Moi, je m’en fous.
Pourquoi ce titre ? J’aime le vin rouge et les parfums obstinants. Capiteux est un adjectif qui renvoie à ce qui est enivrant et lourd, et entêtant. Mes narratrices se devaient de faire le même effet, mais elles ont souvent aussi les sens tournés. Revers de médaille, peut-être…
Vous avez fait beaucoup de présentations et de lectures de Capiteuses. Qu’est-ce que les lecteurs et lectrices en pensent ? Pas tant que ça. Deux seulement à Tanger, trois à Casablanca, une à Marrakech, je ne considère pas cela très important. Réactions très diverses. Souvent très ouvertes de la part des hommes. Les femmes se cherchent souvent dans ce texte et s’y trouvent sans s’y trouver vraiment. Les féministes y voient un pamphlet contre les hommes. Elles se trompent. Je ne règle aucun contentieux avec la gent masculine. Bien au contraire. C’est un appel aux sens, qu’ils soient mâles ou femelles. Rien de plus.
Au niveau des lecteurs, plus de femmes ou d’hommes ? Aucune idée. Pas d’importance.
Et vous, qu’en pensez-vous, depuis que vous vivez avec ? Comment vivez-vous cette expérience ? Ecrire n’est pas une expérience. C’est l’expérience avec un « E » majuscule. Je passe mes journées, soit à lire, soit à écrire. Il suffit de bien me connaître pour le savoir. La seule chose que je peux en dire, c’est qu’il est plus terrifiant pour celui qui vit avec moi que pour moi de me voir tant entourée de mots.
Combien d’exemplaires avez-vous vendus à ce jour ? Je l’ignore. Concrètement, pas assez je suppose pour parler en terme de chiffres, mais suffisamment pour que mon éditeur me réclame un prochain opus.
Avez-vous de nouveaux projets d’écriture et pour quand ? J’écris toujours. Presque tous les jours. J’attends juste de savoir quand j’aurai le temps de m’y consacrer complètement et quelle sera la forme définitive de cette chose écrite à venir.
Propos de Stéphanie Gaou recueillis par Paul Brichet
Crédit Photos: Hicham Gardaf
Stéphanie Gaou en 7 dates
1974: naissance
1999: découverte du Maroc
2001: rencontre avec Lisbonne
2005: perte d’un être cher
2008: rencontre avec Dakar
2010: ouverture de la librairie les insolites
2012: publication du recueil Capiteuses
Ils parlent de Capiteuses…
 Antoine Fournier Vis à Paris et voyage pour des grands projets de construction, en ce moment en Amérique du Nord.
Antoine Fournier Vis à Paris et voyage pour des grands projets de construction, en ce moment en Amérique du Nord.
Un soir d’été, de retour de mon chantier, j’ai marché jusqu’à la libraire que je ne m’attendais pas à trouver nichée dans une rue aux activités marginales. Elle était comme une lanterne jaune au milieu des lanternes rouges, une oasis de livres habitée par quelqu’un avec qui on pouvait parler de littérature, de musiques éclectiques, de tout avec gourmandise. Et en rire. La conversation est tout de suite partie vers le théâtral, l’imaginaire, le philosophique ou le délire. Au fur et à mesure de nos rencontres, Stéphanie et ceux qu’elle m’a fait rencontré ont largement contribué à me faire aimer et comprendre Tanger.
J’ai dû rentrer à Paris, abandonner mon nid d’aigle dans la Kasbah et les tangérois auxquels je m’étais attaché. Cela n’a pas été facile. En février, Stéphanie m’a fait un beau cadeau de confiance en même temps qu’il me permettait de garder le lien avec Tanger ainsi que de prolonger notre amitié: elle m’a confié son manuscrit de « Capiteuses » pour que je le remette à son éditeur.
De « Capiteuses » je retiens une sensualité tour à tour baroque et crue, des blessures dévoilées, une même musique verte et bleue qui se transporte de nouvelles en nouvelles, s’enroulant comme une liane entre ces récits où l’humidité corrompt, dissous et détruis parfois mais de laquelle naît aussi la vie comme un cri. J’y sentais Tanger, la méditerranée, et l’amour.
« Capiteuses » me rappelle que la voie des sens, celle du corps -l’incarnation- même si elle mène souvent à la souffrance, ou à des issues fatales est une voie par excellence de la connaissance de l’Autre. Qu’il n’en déplaise aux extrêmes qui réservent cette communion pour plus tard, pour l’après, refusent le « hic et nunc » et prennent le pouvoir en restant dans le confort des idées, plus maléables que les corps, pour le malheur des hommes.
Anas El Hajjaji, fonctionnaire, vit à Rabat.
Je considère Stéphanie comme la Gertrude Stein de Tanger. C’est ainsi que je la vois. Plus qu’une perception, c’est une réalité. Elle est Gertrude Stein. Pour ce qui est de son recueil de poèmes « Capiteuses », je l’ai connu grâce à des marque-pages que Stéphanie avait la gentillesse de me donner après avoir acheté quelques livres. – Comme disait Robert Bresson : « Il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit de sentir. » A partir de là, je peux dire que j’ai pu identifier le parfum d’une sensibilité poétique raffinée qui fera beaucoup entendre d’elle dans les années à venir. « Capiteuses » constitue certes un commencement prometteur pour Stéphanie, j’en suis sûr. Tout ce qu’il faut maintenant, c’est laisser un peu plus de temps au temps pour mûrir la vision qu’elle s’est forgée. Je n’aime pas les critiques littéraires pour deux raisons fondamentales : un, la critique est une suivante de la création littéraire, et pas le contraire ; deux, la critique, surtout à l’heure actuelle, a la tendance extrêmement fâcheuse de poser avec la froideur des laboratoires des règles fixes de l’excellence littéraire. Ce qui conduit à une conformisation du goût. Or, la littérature a toujours été avant-gardiste. La littérature est spirituellement subversive. Il n’est pas à rappeler que les grands textes n’ont pas été salués par la critique à leur apparition. Ce n’est qu’après des années qu’on a reconnu enfin leur valeur. La gloire littéraire est un investissement sur le temps. Il faut à l’écrivain extrêmement de patience et surtout de garder la foi dans son projet. Vous savez, je garde toujours le mot de Charles Bukowski frais dans mon esprit : « Il n’y a finalement qu’une personne capable de juger une oeuvre, c’est l’auteur lui-même. S’il se laisse influencer par les critiques, par les éditeurs, il est foutu. »
 Julie Mazerolles, 28 ans, comédienne, vit à Lyon en France. Amoureuse inconditionnelle de Tanger. Y a vécu trois mois rue Ibn Oualid Khalid. Elle fréquentait beaucoup les insolites.
Julie Mazerolles, 28 ans, comédienne, vit à Lyon en France. Amoureuse inconditionnelle de Tanger. Y a vécu trois mois rue Ibn Oualid Khalid. Elle fréquentait beaucoup les insolites.
Les insolites, un lieu atypique dans le contexte marocain mais aussi plus généralement, un lieu où il fait bon venir trainer ou papoter à souhait parce qu’il permet de cultiver une conscience éclairée du monde, tout simplement aussi peut-être parce que c’est un lieu construit avec beaucoup d’amour, n’en déplaise à la dictature économico financière… Un lieu que je trouve cohérent par rapport à la beauté impalpable mais néanmoins charmante de Tanger.
Capiteuses a comme première qualité d’avoir une écriture généreuse, claire et rythmique. La langue est riche, la syntaxe juste et ciselée rend cet objet littéraire aussi seyant qu’une parure de haute couture…
A travers une narration subtile et discrète, le lecteur/trice assiste aux récits, témoignages, confessions et pensées de différentes facettes féminines qui pourraient cependant toutes appartenir à une seule. Il n’y a pas vraiment de personnages mais une mélodie faite de voix distinctes aspirant pourtant toutes à l’expression d’une intensité débordante. Il s’agit donc d’une balade au cœur du féminin, un féminin insaisissable qui se transforme en permanence dans l’altérité sexuelle et/ou amoureuse. Capiteuses pourrait ainsi affoler les bien-pensants (ceux qui vivent et pensent à moitié) par sa sincérité quasi carnassière ; il y a du beau et du profond dans ces sentiments troubles, ambigus, parfois extrêmes ou désespérés, que l’on tait par pudeur ou par honte, mais que l’on vit de l’intérieur avec une intensité dévorante. L’écriture de Stéphanie Gaou aiguise et attise ainsi avec humour, tendresse et passion une certaine acuité à être au monde, à se savoir vivre ; nue, belle, seule et forte au milieu d’un exil transcendant. En suivant les variations du rythme de l’écriture on savoure les distinctions, parfois les nuances qui mènent du sensuel au charnel, de la lenteur à la contemplation.
Je trouve que c’est un livre beau et simple à lire parce qu’il y a une forme de véracité déconcertante, une auto-dérision parfois suggérée qui permet d’éviter tout pathos ou faux-semblant. Il n’y a pas de chronologie imposée au lecteur, au contraire la typographie comme la narration nous invitent à nous perdre dans l’espace-temps et piquent notre curiosité pour retrouver certaines correspondances ou échos entre humeurs, images et sensations.
En somme, il s’agit d’une étreinte poétique qui nous emporte vers un féminin infini, pur et entêtant.
 Jean Zaganiaris, enseignant, vit à Rabat.
Jean Zaganiaris, enseignant, vit à Rabat.
Je mène actuellement une recherche sur la littérature marocaine. Lorsque j’ai vu la sortie de l’ouvrage, cela m’a beaucoup intéressé. J’ai pris contact avec Stéphanie Gaou par mail et elle eu la gentillesse de me l’envoyer. Ensuite, nous sommes rencontrés sur le plateau de Luxe radio, où elle est venue présenter son livre.
Je connais la librairie les insolites où j’ai présenté une conférence sur la transidentité dans l’oeuvre de Khatibi, Leftah et Taïa ; c’est un lieu chaleureux, intimiste. La déco est super et les livres y sont à l’aise.
Dans Capiteuses, j’ai beaucoup aimé la façon dont le livre parle du désir féminin, sans vision culpabilisatrice ou bien sans verser dans un romantisme qui donne bonne conscience au récit. Il redonne au corps féminin ses lettres de noblesse dans le domaine de la sensualité ; à l’image de ce que fait Pascal Quignard. Les personnages ont des relations avec des hommes, ressentent du plaisir sexuel, sans que cela soit forcément lié à une relation amoureuse. Cela fait écho un peu à « Q », le film de Laurent Bouhnik, qui lui aussi montre de bien belles capiteuses. J’ai également apprécié ces hybridités culturelles, ces visions cosmopolites qui sont entre les lignes du récit, qui se déroule au Maroc, en France, au Sénégal. J’ai trouvé cela très beau.
Abdeslam Sika, un fidèle de la librairie.
« Capiteuses » est à mon avis un livre qu’on ne se lasse pas de lire et relire… parce qu’on est porté par un élan poétique certain, économie de mot mais qui en dit long sur la vie et les gens, un questionnement perpétuel sur ce qui fait le fondement de notre être. Le lire en journal intime serait une gageure, car il parle de TOUT et de RIEN. L’auteure déborde d’imagination et affiche une grande sensibilité artistique et humaine. N’oublions pas que l’auteure est une poétesse de grand talent c.a.d UNE voltigeuse… Capiteuses est pour moi un recueil poétique traversé par un romantisme à la recherche du temps perdu…
 Leïla Hafyane, enseignante, écrivaine, vit à Casablanca, auteure de « Pages parallèles » « L’Autre Silence » chez L’Harmattan.
Leïla Hafyane, enseignante, écrivaine, vit à Casablanca, auteure de « Pages parallèles » « L’Autre Silence » chez L’Harmattan.
Marrakech. Une soirée de printemps. Artistes, peintres, écrivains, réalisateurs, comédiens, monsieur et madame tout le monde. Sous un même toit. La maîtresse de maison accueille. Tout Sourire. Ce charivari bon enfant. La musique s’est tue. Forcée. Les voix, hautes, enflammées, rires déployés forcent son silence. D’entre les rires, une jeune sylphide, en robe fluide, s’avance vers moi. Je le comprends après coup, le regard de l’artiste. Je le comprends après coup, l’élan de l’auteur. On se présente, l’une l’autre. Stéphanie Gaou/Leïla Hafyane. Les mots sont jetés sur le tapis vert du jeu. Le hasard s’en mêle: libraire/écrivain. Double gagnant. On se parle peu. Le minimum pour un échange de coordonnées. On s’observe. On se vole comme font les écrivains des vivants. Avaler pour mieux rendre: en mots sonnant. J’intéresse sa plume et la mienne y trempe non sans intérêt.
D’elle je retiens le métier et le sourire. Puis je l’oublie dans les livres.
Une ou deux années plus tard, Mon écran renvoie sur une page claire ce nom, sorti du noir de la mémoire, Stéphanie Gaou. Plus bas, un autre. Capiteuses ça monte à la tête.
Je la revois dans une rencontre signature à Casablanca. L’écoute lire avant de lire. Capiteuses. Piège. On ne lit plus à ce moment. On lit l’autre. Cesse-t-on jamais de lire dans l’autre ? Qu’écrit-on ? Si ce n’est des parcelles de soi.
Capiteuses, une coulée d’images. Un puzzle qui souffrirait d’être assemblé. Désassemblé, il pousse des portes qui s’ouvrent sur Elle, Elle en Lui, Lui en Elle. Des anonymes doubles. Doublement intrigant. Et nous alors ? Nous en Elle, happées. Le je m’emmêle. Démêle les elles en elle. Elle le regarde. Elle l’aime. Elle le dissout, dans le ciel, la mer, le vin, il goutte sur la ville, sur le carrelage des chambres de la ville: page froide du désir exacerbé, page chaude d’un lit à peine quitté. Qui est lui ? L’inconnu qui laisse tant de mélancolie.
Capiteuses fait du bruit, un bruit de mots. Ça craque, ça brise ; prive l’attente : inattendu. Le mot prend par surprise, assène des coups. Dos au mur, la phrase abdique, se rend. La phrase de Gaou, femme capiteuse, impatiente, fébrile.
Femme en attente, à la Edward Hopper, un verre, sur le comptoir des mots. En partage, en silence, en elle.

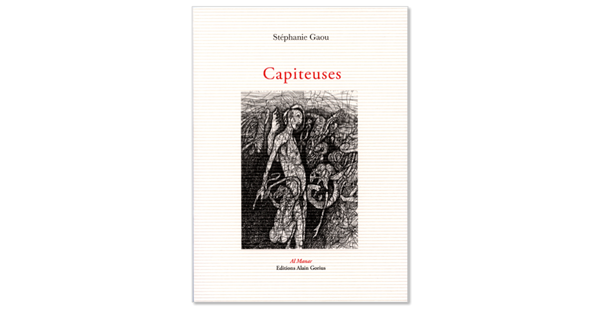

J’ai lu Capiteuse. Une écriture sobre, incisive, un peu à la Duras.
Mais dure aussi.
Comme le signe de la recherche éperdue d’un complément indispensable, comme le yin s’emboite étroitement dans le yang.
Des mots souvent répétés qui induisent la violence des sensations, des émotions ; des sentiments ? Peut être…
Et ces mots reviennent d’un texte à l’autre, mots de passion mais aussi mots de désespoir de jamais rencontrer l’autre dans une autre durée que celle de l’instant :
« épuisée, éreintée, essoufflée, consumée, écroulée, affamée, effondrée, enfourchée, empoignée, éperdue, déchirée, écartelée, rassasiée, extenuée, affamée… ».
A la fois exigence et soumission à l’homme-objet-de-désir, plus que personne à aimer.
Hommage aux femmes ? vraiment?
J’ai lu Capiteuse. Une écriture sobre, incisive, un peu à la Duras.
Mais dure aussi.
Comme le signe de la recherche éperdue d’un complément indispensable, comme le yin s’emboite étroitement dans le yang.
Des mots souvent répétés qui induisent la violence des sensations, des émotions ; des sentiments ? Peut être…
Et ces mots reviennent d’un texte à l’autre, mots de passion mais aussi mots de désespoir de jamais rencontrer l’autre dans une autre durée que celle de l’instant :
« épuisée, éreintée, essoufflée, consumée, écroulée, affamée, effondrée, enfourchée, empoignée, éperdue, déchirée, écartelée, rassasiée, extenuée, affamée… ».
A la fois exigence et soumission à l’homme-objet-de-désir, plus que personne à aimer.
Hommage aux femmes ? vraiment?
Ambiguïté d’abrupt et de douceur. De descriptions crues et pourtant pleines de pudeur. Ambiguïté autour de la relation du corps et du cœur. Ambiguïté de l’amour « je n’ai aimé que lui, mais c’est lui, le seul, lui que j’ai quitté », ambiguïté même au sein de sa soif sexuelle, du désir, qui même assouvi semble ne pas la réjouir mais plutôt la briser. La narratrice (c’est plus facile de se référer à une seule…) utilise des adjectifs souvent repris tout au long du récit : épuisée, éreintée, exténuée, consumée… J’entends cela comme une musique triste au fil des pages qui racontent, comme dans une pièce de théâtre en plusieurs actes, des douleurs, des vertiges, des désespoirs, des colères, des exils, des attentes …
Femme libérée sans doute mais pas libre parce que soumise à ses désirs, parce que cloîtrée dans ses dilemmes : des possibles, des impossibles, des avancées, des retraits, le flux et le reflux. L’eau et le feu, la mer et le désert. « Il n’y a rien d’autre à faire ici : aimer, être seule et puis mourir ». Elle parle de «disparaître », elle parle « d’infertilité d’avenir ». Beaucoup de solitude et de désespérance.
Ce livre est un cri d’amour même si l’auteure s’en défend, un cri d’amour lancé à sa mère, lui exprimant qu’au travers de ses expériences de femme, elle comprend maintenant… Une femme/enfant peut en cacher une autre…
Pour moi, «Capiteuses » est aussi un hommage aux hommes. Ils sont l’objet du désir et son assouvissement, ils comblent les manques, les vides, la solitude. « Ils » indispensables pour « elle », femme en quête d’AMOUR, et pourquoi pas, la question ne m’a pas paru insensée, en quête de l’amour…du père ?!
Plus qu’un bruit de mots à la Hopper, j’entends un long sanglot à la Mahler…
Je me retrouve dans certains aspects de votre commentaire et j’aime beaucoup votre conclusion sur Mahler, j’entends déjà la 5 éme…
Ambiguïté d’abrupt et de douceur. De descriptions crues et pourtant pleines de pudeur. Ambiguïté autour de la relation du corps et du cœur. Ambiguïté de l’amour « je n’ai aimé que lui, mais c’est lui, le seul, lui que j’ai quitté », ambiguïté même au sein de sa soif sexuelle, du désir, qui même assouvi semble ne pas la réjouir mais plutôt la briser. La narratrice (c’est plus facile de se référer à une seule…) utilise des adjectifs souvent repris tout au long du récit : épuisée, éreintée, exténuée, consumée… J’entends cela comme une musique triste au fil des pages qui racontent, comme dans une pièce de théâtre en plusieurs actes, des douleurs, des vertiges, des désespoirs, des colères, des exils, des attentes …
Femme libérée sans doute mais pas libre parce que soumise à ses désirs, parce que cloîtrée dans ses dilemmes : des possibles, des impossibles, des avancées, des retraits, le flux et le reflux. L’eau et le feu, la mer et le désert. « Il n’y a rien d’autre à faire ici : aimer, être seule et puis mourir ». Elle parle de «disparaître », elle parle « d’infertilité d’avenir ». Beaucoup de solitude et de désespérance.
Ce livre est un cri d’amour même si l’auteure s’en défend, un cri d’amour lancé à sa mère, lui exprimant qu’au travers de ses expériences de femme, elle comprend maintenant… Une femme/enfant peut en cacher une autre…
Pour moi, «Capiteuses » est aussi un hommage aux hommes. Ils sont l’objet du désir et son assouvissement, ils comblent les manques, les vides, la solitude. « Ils » indispensables pour « elle », femme en quête d’AMOUR, et pourquoi pas, la question ne m’a pas paru insensée, en quête de l’amour…du père ?!
Plus qu’un bruit de mots à la Hopper, j’entends un long sanglot à la Mahler…
Je me retrouve dans certains aspects de votre commentaire et j’aime beaucoup votre conclusion sur Mahler, j’entends déjà la 5 éme…