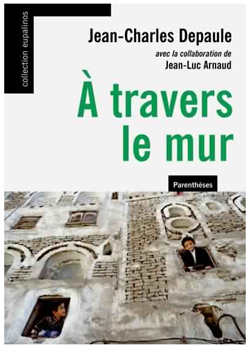 « Il s’agit de la façon dont les corps, les vues et les sons franchissent la frontière de l’habitation dans les villes de l’Orient arabe — Le Caire, Damas, Alep, Sanaa — ; de la manière que la vie quotidienne a d’y définir des territoires, de contrôler leurs limites, de négocier des passages ; et de l’espace sur lequel celle-ci prend appui ou achoppe, des lieux qu’elle investit, neutralise ou détourne. Il s’agit de murs, de portes, de fenêtres, de balcons, de gestes, de mouvements, de regards et de mots. » Ce livre s’attache aux arts de faire, aux seuils et aux ritualisations, mais aussi aux solutions constructives, dont ils sont l’objet. Il accorde une attention toute particulière au langage : à la façon dont les dénominations et formules ordinaires, dont les proverbes et la littérature, d’Adonis à Ghassan Zaqtan en passant par Naguib Mahfouz et Mahmoud Darwich, disent ce qui se passe « à travers le mur ».
« Il s’agit de la façon dont les corps, les vues et les sons franchissent la frontière de l’habitation dans les villes de l’Orient arabe — Le Caire, Damas, Alep, Sanaa — ; de la manière que la vie quotidienne a d’y définir des territoires, de contrôler leurs limites, de négocier des passages ; et de l’espace sur lequel celle-ci prend appui ou achoppe, des lieux qu’elle investit, neutralise ou détourne. Il s’agit de murs, de portes, de fenêtres, de balcons, de gestes, de mouvements, de regards et de mots. » Ce livre s’attache aux arts de faire, aux seuils et aux ritualisations, mais aussi aux solutions constructives, dont ils sont l’objet. Il accorde une attention toute particulière au langage : à la façon dont les dénominations et formules ordinaires, dont les proverbes et la littérature, d’Adonis à Ghassan Zaqtan en passant par Naguib Mahfouz et Mahmoud Darwich, disent ce qui se passe « à travers le mur ».
Vendredi 16 janvier à 19 h à l’occasion de la parution de À travers le mur
Jean-Charles Depaule (1945) a enseigné à l’Ecole d’architecture de Versailles avant de poursuivre au CNRS ses recherches en anthropologie urbaine sur les espaces habités de l’Orient arabe. Il est également poète et traducteur.
Librairie des Colonnes
54, Boulevard Pasteur
Tanger
Analyse de Anne-Charlotte Millepied,
« Jean-Charles Depaule, À travers le mur », Lectures, Les comptes rendus, 2014, mis en ligne le 16 juin 2014, consulté le 16 janvier 2015. URL : http://lectures.revues.org/14944
1 – Dans cette réédition de l’ouvrage À travers le mur, d’abord paru en 1985, Jean-Charles Depaule analyse les modes d’habiter propres aux villes du monde arabe, en particulier Le Caire, qu’il connaît bien, mais aussi Damas, Alep, Sanaa ou Beyrouth. Il conduit ce travail grâce à l’étude de l’architecture et des modulations individuelles dont elle fait l’objet, de la manière dont l’intérieur et l’extérieur sont en relation, toujours à travers la thématique de l’ouverture et de la fermeture, du jeu entre le voir et le non-voir. Ce livre traite ainsi de la ritualisation des seuils et des limites : portes, fenêtres, balcons, loggias, porches…, seuils, extérieurs comme intérieurs, que chacun s’approprie différemment, selon sa catégorie sociale et son sexe.
2 – Se situant dans la continuité d’une anthropologie qui entretient des liens étroits avec la littérature, l’ouvrage est jalonné de citations diverses et d’extraits de romans. La littérature orientale comme les récits de voyageurs occidentaux viennent nourrir la réflexion de l’anthropologue, dont l’écriture est elle-même empreinte de qualités littéraires.
3 – La circulation entre le réel et l’imaginaire se révèle dans la capacité de l’auteur à faire se promener le lecteur : le regard se déplace au fur et à mesure de la lecture, sur les murs, puis à travers le mur, de l’extérieur vers l’intérieur, aidé par les croquis et photos qui illustrent le texte. Le thème constant de l’habitat arabe, présent tout au long du livre, est le « voir sans être vu », souvent présenté comme un privilège féminin : les ouvertures sur les façades permettent aux regards de se porter sur la rue, sans que l’inverse ne soit possible.
4 – L’entrée dans une habitation est l’objet d’une négociation, et se fait différemment selon que le visiteur est familier ou étranger. Il y a une manière bien particulière de signaler sa venue ; par exemple, se faire entendre est « une manière d’indiquer sa position, et de repérer celle d’autrui ». Le seuil doit se considérer comme un espace liminaire : l’individu n’est plus dehors, mais il n’est pas encore dedans. Une fois la porte franchie, il accède au vestibule et à la cour.
5 – La ‘atabe est le seuil présent à l’entrée de chaque pièce, marqué par une pierre de seuil, et le plus souvent par un changement du motif du dallage. C’est un « véritable entre-deux », un lieu de passage physique et symbolique, où se tiennent les domestiques, où l’on dépose ses chaussures avant de réellement être à l’intérieur.
6 – L’auteur développe une analogie entre la maison et le vêtement, au cours d’un passage sur l’habillement féminin, très intéressant en cette période de polémique sur le « voile islamique ». Les précisions apportées viennent remettre les choses en perspective. Il importe de saisir l’évolution du voile dans le temps et la distinction vestimentaire que l’on peut faire entre les femmes du peuple (la « fille du pays ») et les femmes de la haute société. Ici encore, on retrouve l’opposition entre extérieur et intérieur : reprenant l’expression « vêtement à fonction de voile », développée par Dominique Champault, l’auteur nous dit qu’il faut « voir dans le voile féminin comme un fragment détaché du mur de la maison » (p. 51), qui permet d’aller vers l’extérieur sans vraiment quitter le « dedans ». Le mur comme le voile entretiennent mutuellement une relation métonymique : dérober aux regards est leur fonction commune. En effet, si le voile peut être vu comme le prolongement de la réclusion, il peut aussi être considéré comme ce qui permet à la femme d’être mobile. Plus généralement, le vêtement est un révélateur social : on se change pour s’adapter aux situations et aux lieux ; il confirme certaines limites et en révèle d’autres moins visibles.
7 – Jean-Charles Depaule opère une distinction entre le petit espace urbain et le grand. Au Caire, la hetta ou hâra désignent « non seulement une rue, mais [englobent] le réseau hiérarchisé de voies desservant un ensemble d’habitations voisines ». À travers ces deux termes, on observe une « correspondance langagière entre la voie, l’unité résidentielle et le groupe des habitants » (p. 86). La hâra est un « espace plein », qui n’est pas uniquement un lieu de passage, un filtre, ou le lieu d’activités occasionnelles spécifiques, mais le lieu d’événements qui peuvent être quotidiens comme extraordinaires. Lors des fêtes et mariages, l’occupation de l’espace peut complétement entraver le passage – une vieille tradition –, ce qui participe d’une extériorisation de la vie. Au quotidien, la rue ou la ruelle accueille les jeux des enfants ; les femmes discutent et vaquent à leurs occupations (cuisine, lessive…) et les habitants portent des vêtements d’intérieur (on l’a vu, les vêtements sont significatifs des situations). Ce débordement sur l’extérieur, spécifique du Caire, s’explique notamment par l’exiguïté et la précarité des logements, mais n’est pas qu’une nécessité. C’est la sociabilité, ouverte, qui s’exprime ici. Il y a donc une extension du privé devant les murs, sur le seuil ou dans la rue, mais elle ne signifie pas une disparition des frontières : ces dernières sont déplacées vers l’avant, vers l’espace urbain. Il s’agit d’une « construction territoriale collective à l’échelle d’un morceau de ville » (p. 90). Il faut souligner que cette forme de privatisation collective n’est pas une habitude villageoise, mais celle de la figure populaire de l’ibn al-abad (fils du pays).
8 – Il y a donc des frontières et elles sont contrôlées. Elles sont plus ou moins visibles et se déclinent sous plusieurs formes : rétrécissement de la ruelle, personne se tenant à « l’entrée ». Les enfants permettent le relais de l’information quand un visiteur arrive. Les ordures constituent un autre marquage du territoire, fonctionnant comme une « borne » : elles sont balayées et rejetées vers l’extérieur, hors de la limite de la hâra. De plus, une terrasse de café située hors du territoire collectif, peut faire office de point de contrôle, où les hommes (c’est un espace masculin) peuvent observer la ruelle ou l’impasse qui se trouve en face.
9 – La journée, cet espace de la hâra est celui des femmes. L’association du féminin au domestique prend sens lorsque le mari rentre à la maison : la femme se recentre et les activités communes féminines (discussions sur les seuils) s’interrompent alors. Sous le regard des hommes, les femmes ont cette moindre liberté, ce qui fait dire à l’auteur que « le retour des maris fait rentrer chacune chez elle » (p. 98).
10 – Mais cette forme d’appropriation de l’espace n’exclut pas les différences sociales existant notamment entre la hâra et les immeubles aisés où le contrôle du franchissement est délégué au portier (d’autant plus avec le développement des gated communities). De plus, tout le monde ne partage pas ce mode de vie « communautaire » : au sein même des classes populaires, on observe une réticence de certaines familles face à cette extraversion, qui préfèrent un comportement plus discret.
11 – Cette extension du familier et de ses limites vers l’espace urbain n’est pas toujours possible. Quand il n’y a pas de rue à investir, le hall d’immeuble ou le palier d’étage (souvent le lieu d’activités féminines) peuvent la remplacer. D’autres lieux d’expression, représentant des seuils, des ouvertures ou des fermetures sont les fenêtres, balcons et terrasses. Fenêtres et balcons mettent en contact l’intérieur et l’extérieur : « la fenêtre est un objet “alternatif” qui se prête aux virtuosités quotidiennes : tantôt elle interdit le passage, elle est un substitut du mur ; tantôt elle assure son franchissement » (p. 107). Elle est un outil modulable qui permet d’ouvrir, de fermer, ou d’entrebâiller ; de laisser entrer le regard, ou de l’interdire, avec des volets, des rideaux, des grillages, qui permettent par contre à l’habitant de regarder la rue sans être vu. La fenêtre filtre les regards mais contrôle aussi les sons, la lumière et l’air. Un exemple d’intervention de l’habitant peut être de peindre une vitre de fenêtre pour la rendre opaque, jouant ainsi sur la visibilité et la luminosité.
12 – L’extériorisation de la vie se fait aux balcons ou aux fenêtres, où l’on étend le linge pour le faire sécher. Quelle que soit la fonctionnalité du balcon, il est toujours un moyen de communication directe avec le dehors : « pièce supplémentaire, annexe ou débarras, exutoire ou prolongement, il est rare que le balcon ou la loggia soit seulement un lieu dont on jouit pour lui-même, presque toujours il est aussi un palliatif, une réponse à de multiples manques » (p. 163). Le balcon peut aussi servir de support d’expression, plus ou moins ostentatoire, lorsqu’il est orné de carreaux de céramique, de gravures ou de peintures (représentant un pèlerinage par exemple).
13 – Jean-Charles Depaule se livre également à des analyses architecturales et notamment à une description des moucharabiehs, essentiels dans le dialogue de l’habitant avec l’espace. Il repère les changements architecturaux et urbains, qui impactent les modes d’habiter. On observe des ruptures et des innovations, souvent importées de l’étranger (surtout à partir de la période coloniale), dans les matériaux comme les techniques. La nouveauté rencontre les savoir-faire traditionnels, ce qui donne lieu à une intervention des habitants sur leur environnement. Ils modèlent leurs terrasses, balcons et fenêtres : « l’usage “retravaille” la structure qui lui est proposée-imposée, jusqu’à en récréer une nouvelle » (p. 148).
14 – En analysant conjointement les réalités architecturales et les manières d’habiter qui leur sont associées, cet ouvrage nous rappelle la communication permanente et essentielle entre l’espace physique et les pratiques sociales. Le fixe et l’éphémère se rencontrent dans les diverses et complexes appropriations critiques de l’espace, qui servent à moduler les relations entre intérieur et extérieur, en jouant sur les limites – tant symboliques que physiques – et leur franchissement.
Notes
1 Dominique Champault, « Espaces et matériels de la vie féminine sur les hauts plateaux du Yémen », in J. Chelhod, L’Arabie du Sud, histoire et civilisation, 3 – Culture et institutions du Yémen, Maisonneuve et Larose, Paris, 1985.
2 Le moucharabieh (écriture française), spécialité égyptienne, désigne, au sens strict, une « boîte » grillagée en saillie vers l’extérieur. Pour citer l’auteur : « Par métonymie, le terme en est venu à désigner la technique du bois tourné, fort ancienne (elle date au moins du Moyen Âge) qui est employée pour la confection de la grille en bois ; la grille de bois elle-même et la structure grillagée, en encorbellement, formant un balcon fermé » (p. 136).

